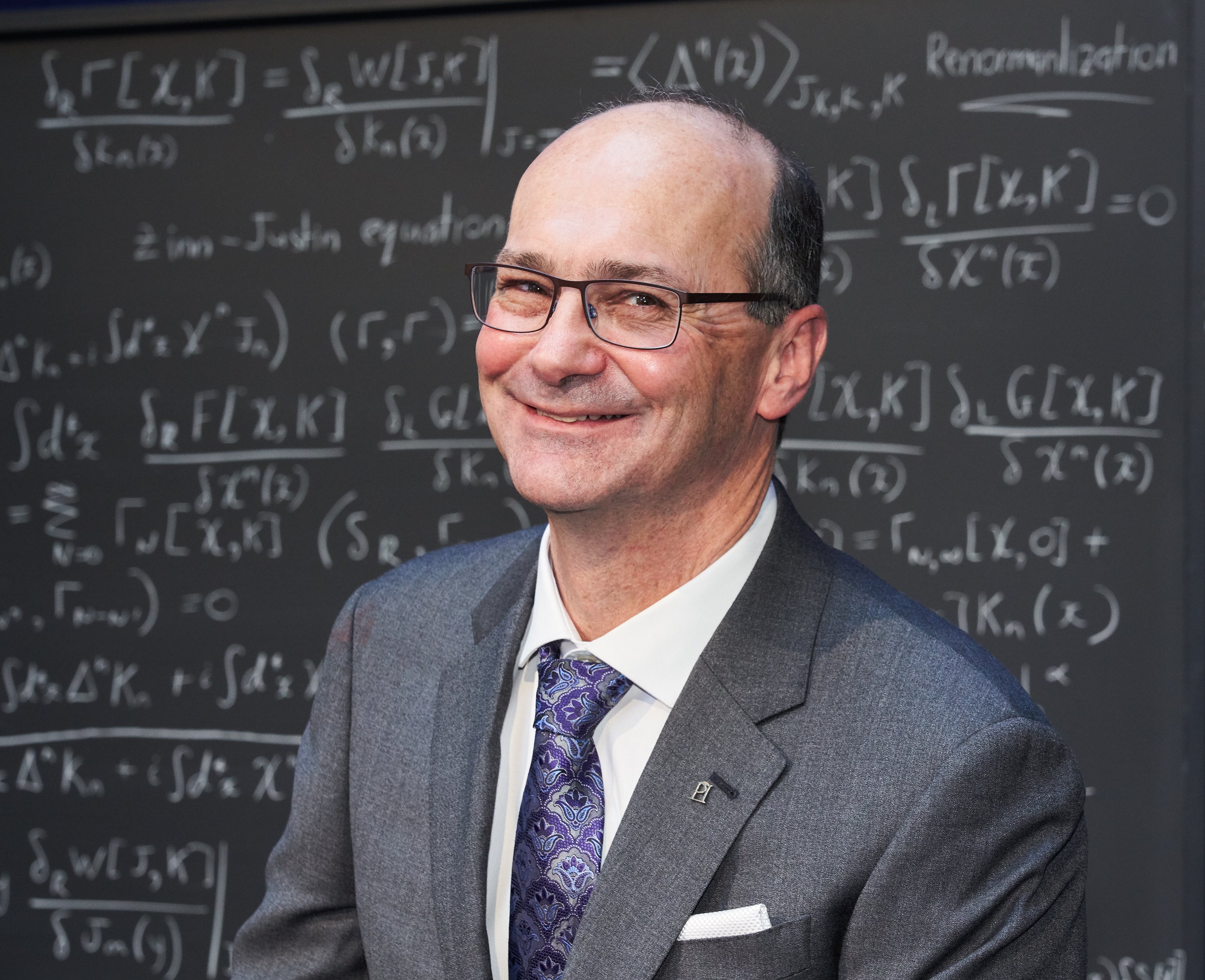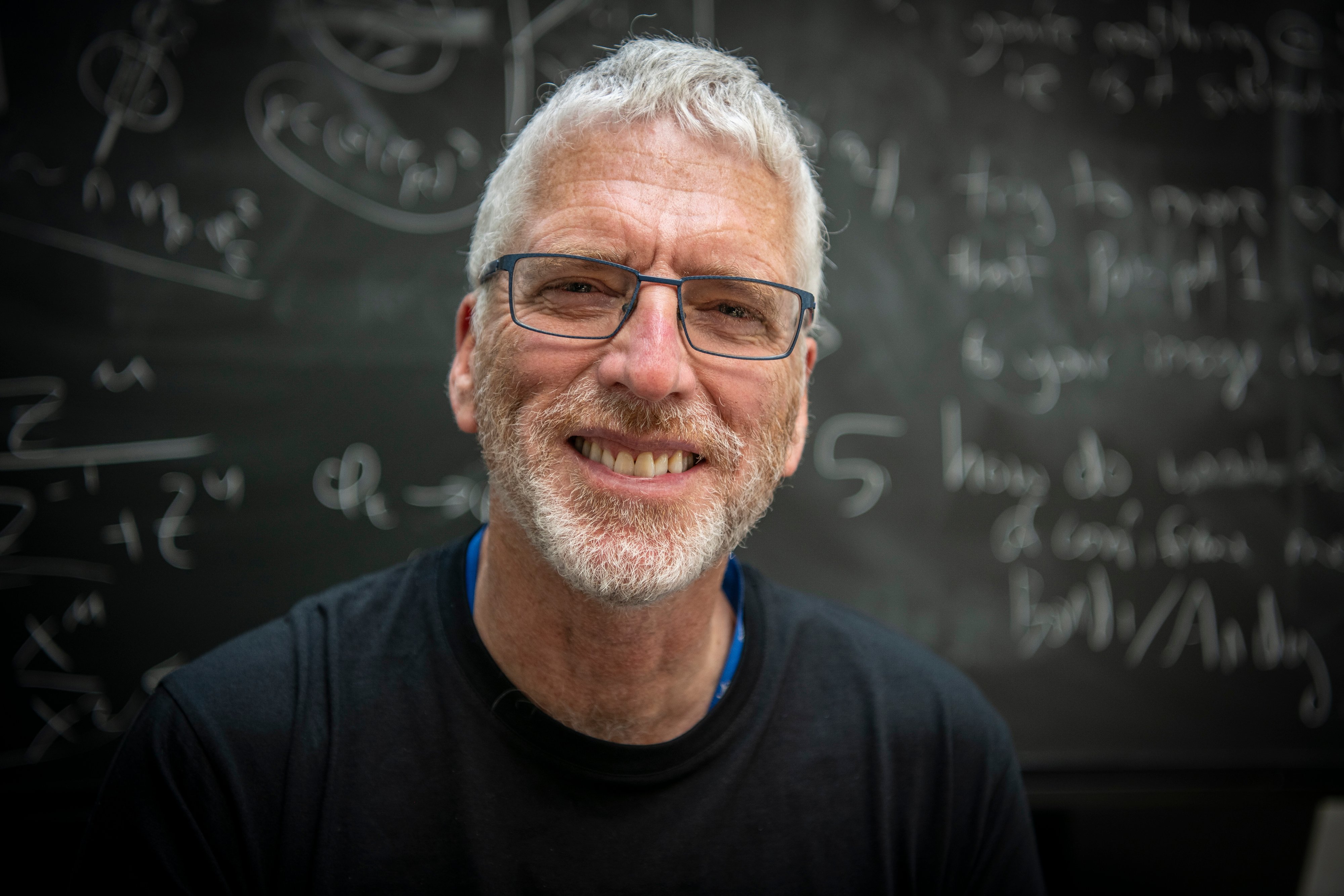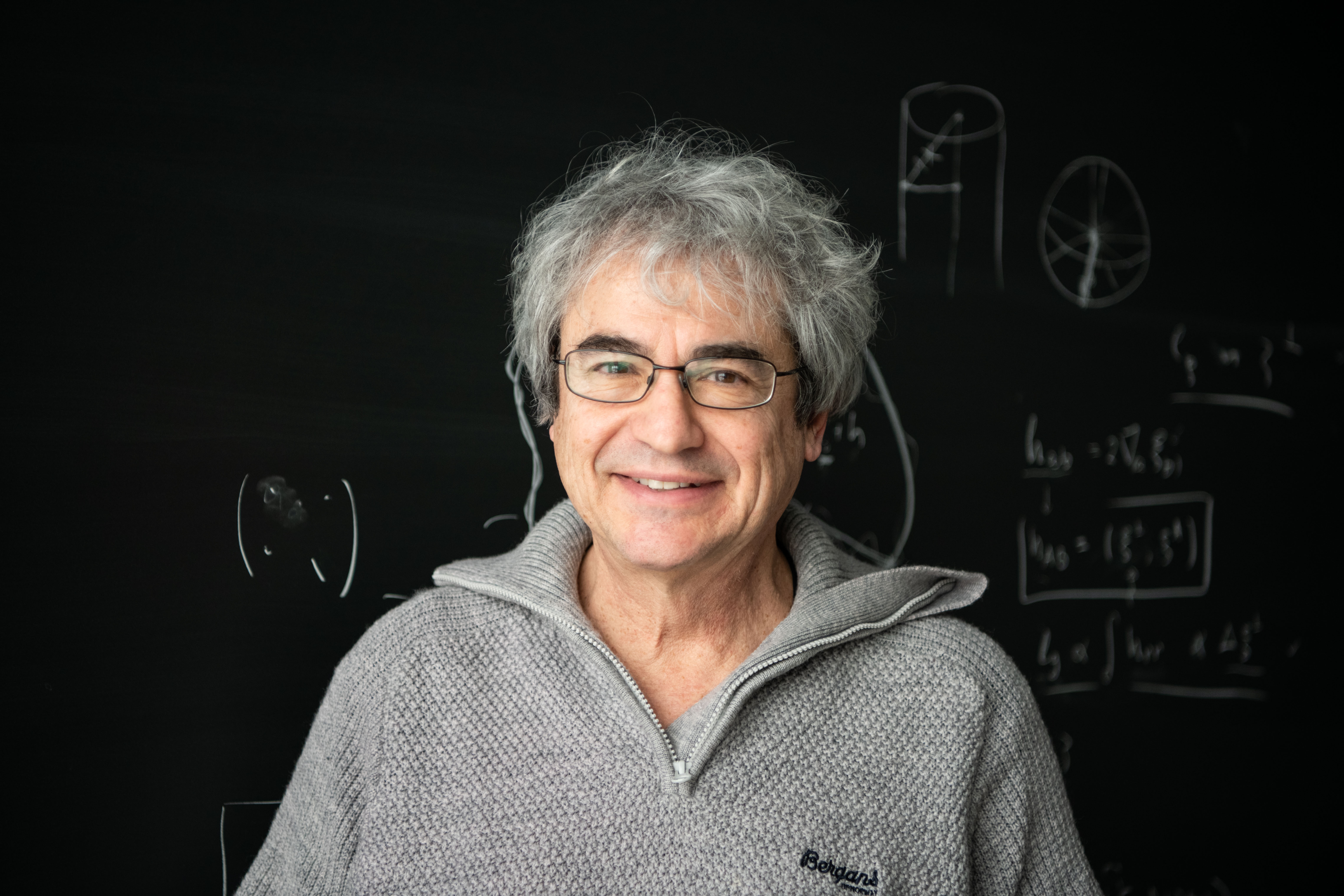Un certain scepticisme était tout à fait naturel lorsque, autour de l’an 2000, on demandait à des chercheurs de se joindre à un nouvel institut canadien de physique théorique situé dans un endroit appelé Waterloo.
À l’aube du nouveau millénaire, la petite ville de Waterloo commençait à se faire connaître comme le berceau du téléphone intelligent BlackBerry et de l’excellente école d’informatique de l’Université de Waterloo. Elle s’imposait comme un pôle technologique en pleine croissance.
Mais pour les physicien·ne·s théoricien·ne·s d’instituts tels qu’Oxford, Cambridge, Harvard ou le MIT, l’Institut Perimeter de physique théorique n’était pas encore sur la carte.
Mike Lazaridis, fondateur de Research In Motion (devenue plus tard BlackBerry), avait non seulement investi des fonds dans l’Institut, mais il y avait aussi consacré du temps, de l’énergie et des conseils. Howard Burton, le tout premier directeur, apportait quant à lui une énergie déterminante.
Mais sans une équipe de physicien·ne·s théoricien·ne·s d’exception, l’expérience aurait tourné court. Et les attirer à Waterloo n’était pas une tâche facile.
Heureusement, quelques esprits audacieux ont accepté de prendre le risque.
Le théoricien des cordes — et futur directeur de Perimeter — Rob Myers a été parmi les premiers à s’engager. Il a été rejoint dès les débuts par Lee Smolin, cofondateur de la gravitation quantique à boucles, qui avait déjà publié un ouvrage de vulgarisation à succès, The Life of the Cosmos. L’experte en gravitation quantique Fotini Markopoulou faisait également partie de la toute première cohorte de chercheur·euse·s. Tous trois étaient déjà des scientifiques bien établis.
Des pionniers de l’information quantique comme Michele Mosca et Raymond Laflamme se sont aussi impliqués dès le début, menant en parallèle le lancement et le développement de l’Institut d’informatique quantique (IQC) à l’Université de Waterloo en 2002 — également grâce au financement de Lazaridis.
Pour compléter l’équipe originale de neuf scientifiques de Perimeter, quatre chercheur·euse·s postdoctoraux se sont joints à eux : Olaf Dreyer et Oliver Winkler (gravitation quantique), ainsi que John Brodie et Konstantin Savvidis (théorie des cordes).
Forte d’une réelle expertise en théorie des cordes, en gravitation quantique et en information quantique, l’équipe de Perimeter a commencé à attirer d’autres spécialistes, alors que l’Institut lançait officiellement ses activités dans l’ancien restaurant Time Square — rebaptisé SpaceTime Square — un édifice reconverti à partir de l’ancienne poste de Waterloo.
Lucien Hardy, spécialiste des fondements de la mécanique quantique, est arrivé de l’Université d’Oxford. Daniel Gottesman, expert en information quantique, est arrivé du groupe de théorie de Microsoft Research et était boursier du Clay Mathematics Institute. Le chercheur en gravitation quantique Thomas Thiemann venait quant à lui de l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle, près de Potsdam, en Allemagne.
Les théoriciens des cordes Jaume Gomis et Freddy Cachazo sont arrivés autour de 2004–2005. Gomis était auparavant chercheur postdoctoral au CalTech, tandis que Cachazo venait de l’Institute for Advanced Study de Princeton, au New Jersey — le célèbre institut où Einstein a travaillé pendant de nombreuses années.
Le physicien mathématicien français Laurent Freidel a rendu visite à Perimeter dans les toutes premières années, alors qu’il travaillait à l’École normale supérieure de Lyon. En 2006, il s’est joint à l’équipe professorale de façon permanente.
Les scientifiques de renom continuaient d’arriver. Maxim Pospelov est arrivé au début des années 2000 — il se trouvait à l’Université du Québec alors que Perimeter prenait son envol. Cliff Burgess, aujourd’hui professeur associé à Perimeter, était à l’Université McGill lors de sa première visite, à l’époque où l’Institut occupait encore l’ancien bureau de poste.
Ils avaient tous un point en commun : ce sont des physicien·ne·s talentueux·ses qui ont choisi de quitter des institutions prestigieuses pour tenter une nouvelle aventure à Perimeter.
À mesure que de nouveaux chercheurs, tous plus accomplis les uns que les autres, se joignaient à Perimeter, il devenait plus facile d’attirer d’autres membres du corps professoral — ainsi que leurs stagiaires postdoctoraux prometteurs et leurs étudiant·e·s aux cycles supérieurs. Il a fallu du temps, de la persévérance, un optimisme constant et beaucoup de foi, mais peu à peu, l’Institut a pris de l’ampleur.
Celles et ceux qui étaient là à l’époque des débuts se souviennent de l’excitation, de l’énergie et de l’enthousiasme qui régnaient alors qu’ils se retrouvaient dans des repaires bien locaux de Waterloo, comme le Mel’s Diner, pour discuter de physique… et de qui recruter ensuite pour l’Institut. À l’époque, la région de Waterloo était en pleine transformation — passant de ses racines manufacturières à un rôle de premier plan dans le secteur technologique canadien. C’était un milieu entrepreneurial, et l’Institut Perimeter en faisait pleinement partie.
C’était une époque exaltante où tout semblait possible — même transformer une ambitieuse expérience de pensée en une réalité concrète : l’Institut Perimeter.
Voici quelques souvenirs de chercheur·euse·s qui se sont joint·e·s à l’aventure dans les toutes premières années :
Robert Myers
Directeur émérite, titulaire de la Chaire Isaac Newton en physique théorique, financée par BMO Groupe financier
Lorsqu’on a approché Rob Myers il y a 25 ans pour se joindre à ce jeune institut de physique en devenir, Perimeter n’était guère plus qu’une idée folle : celle de bâtir, à partir de rien, un institut de recherche de calibre mondial entièrement dédié à la physique théorique — dans une ville encore largement méconnue du Canada — et qui pourrait rivaliser d’égal à égal avec des établissements comme Oxford, Cambridge ou Harvard, dans un domaine dont les racines remontent à des géants comme Galilée, Newton et Einstein. Rien ne garantissait le succès de cette entreprise. En fait, nombre de figures établies dans le milieu (peut-être même la majorité) croyaient qu’elle était vouée à l’échec.
À l’époque, Rob Myers était professeur titulaire à l’Université McGill et un scientifique respecté au Canada. Il envisageait des possibilités d’emploi aux États-Unis, mais l’idée de déménager sa jeune famille au sud de la frontière rendait la décision difficile. Quitter un poste établi à McGill pour un institut non éprouvé représentait un pari majeur pour Myers et son épouse — deux Canadien·ne·s avec trois jeunes filles. Toutefois, lorsqu’on lui a proposé de se joindre à Perimeter, l’occasion représentait non seulement une chance unique de bâtir quelque chose d’important pour le Canada, mais aussi celle de continuer à élever sa famille ici. Ils ont donc décidé de prendre le risque.
« À mon arrivée, on m’a demandé si je pouvais travailler à la maison, parce qu’il n’y avait vraiment pas de place pour les physiciens », se souvient Myers.
Deux mois plus tard, l’Institut emménageait dans le restaurant Time Square, qui venait tout juste de fermer ses portes. Myers se souvient de l’énergie qui régnait dans le bâtiment rebaptisé Spacetime Square — de l’ambiance informelle, des discussions animées en physique, et des premières visites scientifiques. Il se rappelle notamment du tout premier séminaire, donné par Arkady Tseytlin (sommité de la théorie des cordes à l’Imperial College de Londres) à l’automne 2001. « Nous étions moins d’une douzaine, tous rassemblés autour d’un tableau portatif au troisième étage, car il n’y avait pas encore de salle de séminaire », raconte-t-il.
Un autre moment marquant, selon lui, fut lorsqu’il se retrouva assis entre Steve Giddings (Université de Californie, Santa Barbara) et Joe Lykken (Fermilab) lors d’un séminaire précoce à Perimeter. « Je me souviens très bien avoir pensé : “Oui, ça va marcher” », dit Myers.
Bâtisseur institutionnel dès le départ, Myers est resté à long terme à Perimeter et a joué un rôle fondamental dans son succès. En 2019, il est devenu le troisième directeur général de l’Institut, succédant à Howard Burton et Neil Turok.
Myers a guidé l’Institut — qui repose sur l’énergie des collaborations entre étudiant·e·s et chercheur·euse·s — pendant les années difficiles et imprévisibles de la pandémie de COVID-19. Lorsque les installations ont pu rouvrir, l’Institut demeurait un milieu de recherche florissant, en grande partie grâce à ses efforts.
Il a récemment terminé son mandat de cinq ans comme directeur général et est retourné à la recherche à temps plein à Perimeter, où il occupe maintenant le poste de directeur émérite et la Chaire Isaac Newton en physique théorique, financée par BMO Groupe financier.
« Pour moi, ç’a été un parcours incroyable — et ce n’est pas terminé », confie-t-il. « J’ai eu la chance de participer à la fondation d’un institut, de contribuer à créer quelque chose de nouveau et d’important à partir de rien. Et je me dis que j’ai été drôlement chanceux. Peu de gens ont cette opportunité dans leur vie, et j’en suis profondément reconnaissant. »
« C’était un travail passionnant, mais aussi exigeant », se rappelle-t-il. En plus de l’excitation scientifique, il fallait prendre d’innombrables décisions : comment gérer un institut autrement, comment repérer et recruter les meilleurs talents à tous les niveaux — des étudiant·e·s aux professeur·e·s —, comment nouer des partenariats, et avec qui. L’équipe accueillait aussi des visiteur·euse·s du monde entier pour leur montrer ce qui se passait à Waterloo.
« L’Institut a bénéficié du soutien et de la bonne volonté de nombreux acteurs — les gouvernements fédéral et provincial, le conseil d’administration, les scientifiques de renom du comité consultatif scientifique, l’Université de Waterloo, et la communauté locale », souligne-t-il.
Myers tient aussi à exprimer une gratitude particulière envers Mike Lazaridis pour son appui et les opportunités qu’il a offertes au fil des ans. « Nous lui devons toutes et tous une immense reconnaissance : sans Mike et sa vision, l’Institut Perimeter n’existerait tout simplement pas. »
Michele Mosca
Professeur associé à l’Institut Perimeter, professeur à l’Institut d’informatique quantique de l’Université de Waterloo
Titulaire d’un doctorat en algorithmes de calcul quantique de l’Université d’Oxford obtenu en 1999, Michele Mosca — d’origine canadienne et natif de la région de Windsor — se trouvait déjà à Waterloo au moment du lancement de l’Institut Perimeter.
À l’époque, il mettait sur pied le tout premier groupe de recherche en informatique quantique à l’Université de Waterloo. Aujourd’hui, il est scientifique spécialisé en information quantique à l’Institut d’informatique quantique, en plus d’être professeur associé à l’Institut Perimeter.
Mosca se souvient avoir reçu une note mystérieuse de la part du tout premier directeur, Howard Burton, alors que Perimeter n’était encore qu’un concept. Burton avait déjà communiqué avec Artur Ekert, qui se décrit lui-même comme un « crypto-physicien » — un spécialiste de la cryptographie et de la physique, actif dans le traitement de l’information et les systèmes quantiques à l’Université d’Oxford. Ekert connaissait Mosca, expert en cryptographie post-quantique (qui vise à protéger nos données numériques contre les ordinateurs quantiques capables de briser les systèmes de chiffrement actuels). Le fait qu’Ekert appuie l’idée a grandement influencé la décision de Mosca de lui donner une chance.
Peu de temps après, Mosca se retrouvait en rencontre avec Mike Lazaridis. « Il voyait déjà plus loin, en imaginant tout un écosystème », se rappelle Mosca.
L’idée Perimeter l’intriguait, mais il voulait aussi bâtir un groupe de recherche en informatique quantique à l’université. Lazaridis lui a dit : « Je vais t’aider à faire grandir ce projet. » Et ainsi est né l’Institut d’informatique quantique à l’Université de Waterloo, presque en parallèle avec l’Institut Perimeter, qui est lui resté indépendant.
Mosca se rappelle que l’équipe administrative fondatrice de Perimeter prévoyait initialement louer des bureaux dans le Marsland Centre, une tour à bureaux de Waterloo.
Mais l’occasion s’est présentée d’acquérir le restaurant Time Square, situé dans l’ancien édifice de la poste. C’était l’endroit rêvé. « C’était cool, et on a gardé le bar tel quel », raconte Mosca (même si les robinets ont vite été fermés).
Quelques années plus tard à peine, le bâtiment surnommé Spacetime Square débordait déjà d’activité, et des étudiant·e·s occupaient les locaux du sous-sol, plongés dans la pénombre, se souvient-il.
Il était temps de déménager. Le tout nouveau bâtiment sur mesure de Perimeter — une installation de 65 000 pieds carrés conçue par la firme Saucier + Perrotte — a officiellement ouvert ses portes le 1er octobre 2004, sur un terrain autrefois occupé par l’aréna commémoratif de Waterloo, un don de la Ville de Waterloo.
Lucien Hardy
Chercheur à l’Institut Perimeter
Lucien Hardy, professeur en fondements de la mécanique quantique à l’Institut Perimeter, bénéficiait d’une bourse de longue durée de la Royal Society à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, au moment de la création de l’Institut.
Il était heureux à Oxford — une université prestigieuse et reconnue dans le monde entier — et sa recherche allait bon train. Il s’était déjà taillé une solide réputation dans le domaine des fondements quantiques grâce à son expérience de pensée connue sous le nom de paradoxe de Hardy.
Alors, lorsque Howard Burton l’a contacté, puis envoyé Michele Mosca pour tenter de l’amener à Waterloo, Hardy n’avait absolument pas l’intention de partir. Mais Mosca a tout de même réussi à le convaincre de prendre l’avion pour venir visiter.
À sa rencontre avec les autres physicien·ne·s fondateur·trice·s — notamment Lee Smolin — il a été rapidement séduit par le projet et a décidé de tenter l’aventure.
Ce qui l’a convaincu avant tout, ce sont les personnes derrière cette initiative audacieuse. « J’ai été très impressionné par l’audace de l’ensemble du projet, et j’ai voulu en faire partie », dit-il.
Hardy considère encore l’ancien édifice de la poste comme le foyer spirituel de Perimeter. C’était un lieu où les idées fusaient et prenaient forme au gré des discussions devant les tableaux noirs. On y dormait parfois sur les grands divans, et les conversations autour d’une bière ou d’un repas étaient toujours fascinantes. Ils vivaient, respiraient, vibraient au rythme des étincelles d’idées.
« Mon bureau était à une extrémité du bar, et celui de Lee Smolin était à l’autre extrémité », se souvient Hardy. « À l’époque, je connaissais absolument tout le monde dans le bâtiment. »
Laurent Freidel
Chercheur à l’Institut Perimeter
Laurent Freidel enseignait à l’École normale supérieure de Lyon, en France, lorsqu’il a entendu parler pour la première fois — par l’intermédiaire de Lee Smolin — d’un nouvel institut entièrement consacré à la physique théorique qui était en train de voir le jour à Waterloo.
L’idée lui semblait étrange, mais « c’était aussi attirant et excitant », raconte Freidel. Il avait déjà contribué à la création d’un nouveau laboratoire de physique en France, et il faisait donc partie de ces personnes naturellement attirées par l’aventure du neuf. L’esprit audacieux et entrepreneurial du nouvel institut l’a séduit.
« Il y avait trois ou quatre tableaux noirs sur roulettes, de la bière en fût et du sucre à volonté. Les gens restaient pour travailler 10, 12 heures par jour. C’était comme bâtir une nouvelle entreprise », se souvient-il à propos des premières années.
Freidel est d’abord venu en tant que visiteur, mais dès qu’il a découvert ce local de physique théorique installé dans l’ancienne poste, rempli de jeunes débordant d’enthousiasme et avides de résoudre de grands problèmes en physique théorique, il a su qu’il voulait en faire partie.
Il y avait quelque chose de spécial à Perimeter, dit-il. Un environnement hautement interactif, où les gens collaboraient au-delà — et en dehors — des champs disciplinaires traditionnels. L’équipe administrative était réduite mais très solidaire. Il y avait un véritable esprit de pionnier. « On cassait les règles du milieu universitaire », ajoute-t-il.
« C’était un lieu unique, très audacieux, avec plein d’idées nouvelles et une énergie particulière. Participer à sa construction, dans les premières années, c’était vraiment quelque chose », dit Freidel, devenu le neuvième professeur à temps plein de l’Institut Perimeter.
Raymond Laflamme
Professeur associé à l’Institut Perimeter, professeur à l’Institut d’informatique quantique de l’Université de Waterloo (et ancien directeur général)
Pendant un bref moment, Raymond Laflamme s’est demandé si Howard Burton n’était pas un agent du FBI.
Il raconte avec humour sa rencontre avec Burton, qui insistait pour lui rendre visite à son bureau du Laboratoire national de Los Alamos, aux États-Unis, où Laflamme faisait alors figure de pionnier dans le domaine du calcul quantique.
À cette époque, l’ambiance dans cette installation hautement sécurisée de Los Alamos était particulièrement tendue : les autorités fédérales enquêtaient sur ce qui semblait être une fuite de documents de recherche classifiés vers un gouvernement étranger. Il s’est finalement avéré que la fuite ne provenait pas du laboratoire, mais pendant l’enquête, une certaine paranoïa régnait sur le site.
Laflamme, un Canadien originaire de Québec, savait bien qu’il n’était pas suspect, mais naturellement, tous les étrangers sur ce campus se sentaient nerveux.
Alors, lorsque Burton a appelé Laflamme pour lui demander de lui rendre visite à son bureau, Laflamme a répondu par un « non » catégorique.
« Je ne connaissais pas ce type, alors j’ai dit : “Non, vous ne pouvez pas venir à mon bureau,” » se souvient Laflamme. « J’ai commencé à m’inquiéter qu’il soit un agent du FBI qui enquêtait sur les gens du labo qui laissaient entrer des étrangers sans permission. »
Il a fallu un peu de persuasion, mais Laflamme a finalement accepté de rencontrer Burton – pas dans son laboratoire ou son bureau, mais dans un café situé sur le campus de Los Alamos. Même en attendant l’arrivée de Burton, Laflamme s’attendait presque à voir débarquer un homme en manteau noir sortant d’une voiture noire. À la place, un homme à la barbe courte est arrivé et a commencé à lui parler d’un certain « Institut Perimeter », dont Laflamme n’avait jamais entendu parler. L’homme voulait obtenir des noms de chercheurs qu’il pourrait recruter pour cet institut.
Laflamme, toujours sceptique, hésitait. Il avait du mal à croire que quelqu’un lançait un institut entièrement consacré à la physique théorique au Canada. « Je me suis dit : “C’est quoi cet institut, une plaque sur la porte d’un bureau?” » lance Laflamme en riant. Burton « a dû penser que je n’étais pas très coopératif », admet-il.
Mais quelques mois plus tard, Laflamme a rencontré un collègue physicien respecté qui lui a parlé avec enthousiasme d’un nouvel institut de physique théorique à Waterloo. « Je me suis dit : wow, il en a entendu parler. »
Laflamme envisageait justement un changement et aurait pu aller enseigner dans plusieurs grandes universités. Lui et sa femme pensaient à s’installer à Vancouver, dont elle est originaire. Mais un souper décisif à la ferme de David Johnston, alors président de l’Université de Waterloo (et plus tard gouverneur général du Canada), a changé la donne. Le souper, auquel participait également la famille Lazaridis, a charmé les Laflamme et les a convaincus de s’installer à Waterloo.
Laflamme est ainsi devenu l’un des fondateurs de l’Institut Perimeter, puis le directeur fondateur de l’Institut d’informatique quantique, qui a ouvert ses portes en 2002.
Cliff Burgess
Professeur associé à l’Institut Perimeter, professeur à l’Université McMaster
Cliff Burgess était un visiteur de l’Institut Perimeter à ses débuts, alors que celui-ci occupait encore l’ancien bâtiment de la poste. Aujourd’hui, il est professeur à l’Université McMaster, où il travaille à l’intersection de la physique des particules et de la cosmologie, tout en étant membre associé du corps professoral de Perimeter.
« Il y avait la nouveauté du grand bar avec les chaises, où se tenaient des discussions. Ça ressemblait plus à une jeune pousse qu’à un institut de physique, et c’était vraiment cool », raconte-t-il.
Il a entendu parler de Perimeter pour la première fois alors qu’il était encore à l’Université McGill, à Montréal. Howard Burton, le premier directeur, avait emmené Robert Myers, Maxim Pospelov (ancien professeur associé à Perimeter, aujourd’hui physicien à l’Université du Minnesota) et Burgess dîner pour leur présenter les plans de l’Institut. Burgess admet avoir été sceptique à l’époque. « Les plans semblaient incroyables, mais je me souviens avoir pensé : “Ce serait génial, mais je ne vois pas comment ça va se concrétiser.” »
Mais quand Myers a décidé de quitter McGill pour se joindre à Perimeter, « c’est devenu plus réel », dit-il.
Il se rappelle que Myers a emporté avec lui une tradition de McGill : là-bas, on utilisait un bâton de ski de fond comme pointeur lors des séminaires de physique. À Perimeter, Myers a lancé la tradition d’utiliser un bâton de hockey comme pointeur — une pratique encore en usage aujourd’hui.
Lorsque le nouveau bâtiment de la rue Caroline a ouvert ses portes, sur un terrain qui abritait auparavant une aréna, Burgess est revenu à Perimeter en tant que professeur associé.
Il se souvient du gala d’inauguration du nouveau bâtiment, qui a eu lieu alors que les travaux de construction n’étaient pas encore tout à fait terminés.
« Je me souviens avoir traversé la rue (à ce moment-là, les chercheurs étaient encore principalement dans l’ancienne poste en attendant le déménagement) pour voir où en étaient les préparatifs. L’atrium ressemblait encore à un chantier de construction, presque jusqu’à quelques heures du souper, quand les équipements ont été déplacés. C’était comme voir une explosion à l’envers : le désordre disparaissait pour révéler la salle à manger en dessous », raconte-t-il.
« Inutile de dire que le gala s’est déroulé parfaitement », ajoute Burgess, qui attribue ce succès au talent de Dan Lynch, directeur adjoint du Bistro de Perimeter.
Il ajoute que l’ensemble du personnel non académique a contribué à rendre l’Institut si spécial — et à en faire un succès.
« Tout le monde, de la réceptionniste au directeur, parlait et agissait comme s’il était privilégié de faire partie de cette occasion extraordinaire. L’Institut était alors aussi beaucoup plus petit, et avait une atmosphère très particulière. C’était du genre : “Si j’ai besoin de régler X, je vais parler à Y, et on va trouver une solution aujourd’hui.” »
Robert Spekkens
Chercheur principal
Ayant tout juste terminé son doctorat à l’Université de Toronto vers 2001, Robert Spekkens se demandait si sa carrière n’était pas déjà dans une impasse.
Même s’il avait travaillé en information quantique — espérant que cela suffirait à maintenir sa carrière —, son principal champ de recherche portait sur les fondements de la mécanique quantique, un domaine qui, à l’époque, n’offrait que très peu de débouchés.
Les fondements de la mécanique quantique constituent un domaine de recherche fascinant, avec plus de cent ans d’histoire. Il remonte à des figures historiques comme Louis de Broglie, qui a introduit la dualité onde-particule ; Werner Heisenberg, qui a développé le cadre de la mécanique quantique avant de formuler le principe d’incertitude ; et Erwin Schrödinger, avec son équation d’onde probabiliste décrivant l’évolution des systèmes quantiques dans le temps, qui a ensuite contesté la nature probabiliste de la réalité à travers sa célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger.
Depuis, les physicien·nes théoricien·nes s’efforcent de comprendre : pourquoi ? Pourquoi le comportement des particules dans le monde quantique est-il si étrange comparé à notre réalité quotidienne ? Quelle est la véritable nature de la réalité ? Pourquoi la mécanique quantique fonctionne-t-elle de cette manière ?
Ce sont les grandes questions auxquelles s’efforcent toujours de répondre les chercheurs et chercheuses en fondements quantiques. Même en tant que chercheur postdoctoral en 2001, Spekkens voulait contribuer à cette quête. Mais peu de jeunes physicien·nes étaient embauché·es dans ce domaine à l’époque. L’intérêt était davantage tourné vers les applications de la théorie quantique, comme l’informatique quantique.
Mais Spekkens a eu de la chance. Il a obtenu son doctorat au moment où l’Institut Perimeter se lançait. Voici un nouvel institut qui valorisait les idées non conventionnelles et cherchait à faire croître son groupe de recherche en fondements quantiques.
Spekkens se trouvait à Toronto lorsqu’il a été mis en contact avec Perimeter par Michele Mosca. Il a assisté à une série de séminaires à l’Institut, puis a accepté un poste postdoctoral, alors que Perimeter occupait encore l’ancien bâtiment de la poste.
Pendant l’été, le vieux bâtiment devenait chaud, et les fenêtres restaient souvent ouvertes. Il se souvient que des écureuils entraient pour voler des noix qu’un collègue avait apportées au travail.
« On était en pleine croissance », se souvient Spekkens. Les espaces de travail pour les postdoctorant·es étaient continuellement subdivisés pour accueillir toujours plus de gens.
Spekkens est ensuite parti pour une bourse postdoctorale de trois ans de la Royal Society à l’Université de Cambridge, mais il est revenu à Perimeter en 2008 en tant que chercheur principal.
L’un des aspects que Spekkens a particulièrement apprécié dans les débuts de Perimeter, c’est que l’Institut était construit de manière collective.
« Les réunions administratives ressemblaient à des réunions de faculté et étaient très inclusives. Tous les postdoctorants y assistaient pour entendre les mises à jour. On avait ces rencontres où l’on décidait collectivement de ce que l’Institut allait devenir. C’était vraiment agréable de faire partie de ces discussions, » raconte-t-il.
Quand Spekkens repense à ce qui a fait le succès de Perimeter, il estime que le fait que l’Institut ait osé investir dans des domaines et des idées non conventionnels a été crucial.
« Ils ont placé la barre très haut et ont adopté une approche un peu comme une startup, où l’on recrutait des gens en insistant sur le fait que cet endroit était différent. »
Il y a eu de nombreux facteurs qui ont contribué au succès de Perimeter, mais tout de même, « c’est surprenant qu’on ait réussi à faire tout ça, » ajoute-t-il.
Spekkens affirme que sans Perimeter, sa carrière n’aurait probablement pas pris le tournant qu’elle a connu. « Je dois beaucoup à Perimeter, à Howard Burton, et à la vision de Mike Lazaridis, qui a investi dans la physique théorique et, en particulier, dans les fondements quantiques. »
Carlo Rovelli
Chercheur invité distingué, Perimeter Institute, Professeur adjoint, Western University, Professeur de classe exceptionnelle, Université Aix-Marseille, France
Carlo Rovelli, physicien théoricien reconnu mondialement pour ses ouvrages qui expliquent avec élégance les concepts de la physique moderne au grand public, affirme avoir entendu parler de Perimeter avant même que l’institut n’existe.
Une époque avant le début de la ligne du temps — ce qui semble tout à fait approprié pour quelqu’un qui travaille dans le domaine de la gravité quantique et qui cherche à comprendre de quoi est fait l’espace-temps dans le monde quantique.
Aujourd’hui, Rovelli est un communicateur extrêmement prolifique des grandes idées scientifiques auprès du public. Parmi ses ouvrages populaires, on compte Seven Brief Lessons on Physics; The Order of Time; Reality Is Not What It Seems: The Journey to Quantum Gravity; Helgoland: Making Sense of the Quantum Revolution, ainsi que son plus récent livre, White Holes.
Dans les années 1980, Rovelli a travaillé avec Lee Smolin, qui, quelques décennies plus tard, deviendrait l’un des premiers membres de la faculté de Perimeter. Ensemble, avec d’autres collègues, ils ont cofondé la théorie de la gravité quantique à boucles — une approche dans la quête de plusieurs décennies visant à unifier la théorie quantique et la relativité d’Einstein.
Sans surprise, Rovelli a reçu un appel de Howard Burton à l’époque où l’Institut Périmètre n’était encore qu’à ses balbutiements.
Burton lui a parlé d’un entrepreneur canadien du nom de Mike Lazaridis, qui souhaitait créer un institut consacré à la physique théorique. « Je me suis dit : “wow, merveilleux – un entrepreneur visionnaire qui veut investir dans la recherche fondamentale. Comment puis-je aider ?” »
Burton voulait qu’il rejoigne le corps professoral, mais Rovelli occupait déjà un poste qui lui convenait (il faisait alors partie du corps professoral de l’Université de Pittsburgh).
Il a néanmoins visité l’Institut Périmètre à ses débuts, dans l’ancien bâtiment de la poste, et est depuis devenu un visiteur régulier. Aujourd’hui encore, il y revient fréquemment en tant que chercheur invité distingué. Il a récemment prononcé la toute première conférence publique des célébrations du 25e anniversaire de Périmètre.
En plus de Lazaridis et Burton, Rovelli attribue à Lee Smolin le rôle de « force idéologique » derrière Périmètre. « Sans Lee Smolin, Périmètre ne serait pas devenu ce qu’il est devenu. Il débordait de passion. »
« Pour moi, c’était absolument merveilleux », dit-il en repensant aux débuts de l’Institut. « On créait un espace pour l’esprit, libre et indépendant des grandes universités puissantes. On remettait beaucoup de pouvoir entre les mains des jeunes chercheurs, des stagiaires postdoctoraux, qui participaient autant que les autres à définir ce que l’Institut allait devenir. »
« Ce dont je me souviens surtout, ce sont ces discussions sans fin, à parler, parler et encore parler. Certaines de mes idées sont nées de ces longues conversations, » ajoute-t-il. « Ça me rappelait l’esprit des grands instituts scientifiques dans l’histoire, où les gens se réunissaient simplement parce qu’ils voulaient comprendre. Par pure curiosité. »
This is part two in a series celebrating Perimeter’s history for the Institute’s 25th anniversary celebrations. In part 3, we follow along as the Institute explodes from an unlikely startup to a rock-star establishment stepping out onto the world stage. You can find part 1 here.
À propos de l’IP
L'Institut Périmètre est le plus grand centre de recherche en physique théorique au monde. Fondé en 1999, cet institut indépendant vise à favoriser les percées dans la compréhension fondamentale de notre univers, des plus infimes particules au cosmos tout entier. Les recherches effectuées à l’Institut Périmètre reposent sur l'idée que la science fondamentale fait progresser le savoir humain et catalyse l'innovation, et que la physique théorique d'aujourd'hui est la technologie de demain. Situé dans la région de Waterloo, cet établissement sans but lucratif met de l'avant un partenariat public-privé unique en son genre avec entre autres les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Il facilite la recherche de pointe, forme la prochaine génération de pionniers de la science et communique le pouvoir de la physique grâce à des programmes primés d'éducation et de vulgarisation.
Ceci pourrait vous intéresser



L’avenir des sciences : un panel sur l’IA et la technologie à Halifax avec Perimeter et Volta
février 25, 2025